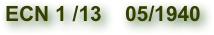En service avec l'ECN 1/13.
C'est la chasse de nuit qui sera le plus grand utilisateur de l'appareil .
Nous allons voir maintenant dans quelles conditions, en nous intéressant plus particulièrement à l'Escadrille 1/13, puisque c'est un des ses avions qui est représenté ici.
A la déclaration de guerre, les quatre escadrilles des deux groupes de chasse de nuit deviennent autonomes. Elles gagnent leurs terrains de campagne dans l'Est parisien, étant chargées de protéger la capitale.
Une cinquième escadrille a pour mission la protection de Lyon.
La 1/13 est alors basée à Meaux -Villenoy avec neuf avions en ligne.
Malgré un bon niveau d'entraînement des équipages, la "Drôle de guerre" montre rapidement les limites d'une organisation où tout reste à inventer.
Le procédé est basé sur un système de guet et d'écoute, qui transmet l'alerte à des batteries de projecteurs, qui sont elles chargées d'assurer le guidage des avions.
Cependant, les guetteurs n'ont pas reçu de formation spécifique, et les transmissions tardent à donner les alertes. On manque de matériels d'écoute et de projecteurs, qui sont eux du modèle 1918 ...
Bref, les avions ne seront jamais dans des conditions favorables d'interception, quand il ne s'agira pas de fausse alerte.
Heureusement, l'activité nocturne de la Luftwaffe reste assez marginale.
Le quotidien de ces vols est à l'image de la première mission de guerre, réalisée le 06/09/39 par l'équipage du Capitaine Treillard (chef d'escadrille) et du Sergent Chef Séghi: décollage à 1h50 du matin dans le brouillard et le black-out total, un vol de 40 mn sans rien trouver, retour au terrain après l’alerte.
Les vols sont effectués par tous les temps, et s'ajoute bientôt des entraînements à la chasse de jour. Les équipages découvrent alors les qualités de maniabilité de leurs appareils , lors des exercices de voltige.
Mais déjà des nominations diminuent à six pilotes, un effectif déjà faible pour assurer l'ensemble des missions.